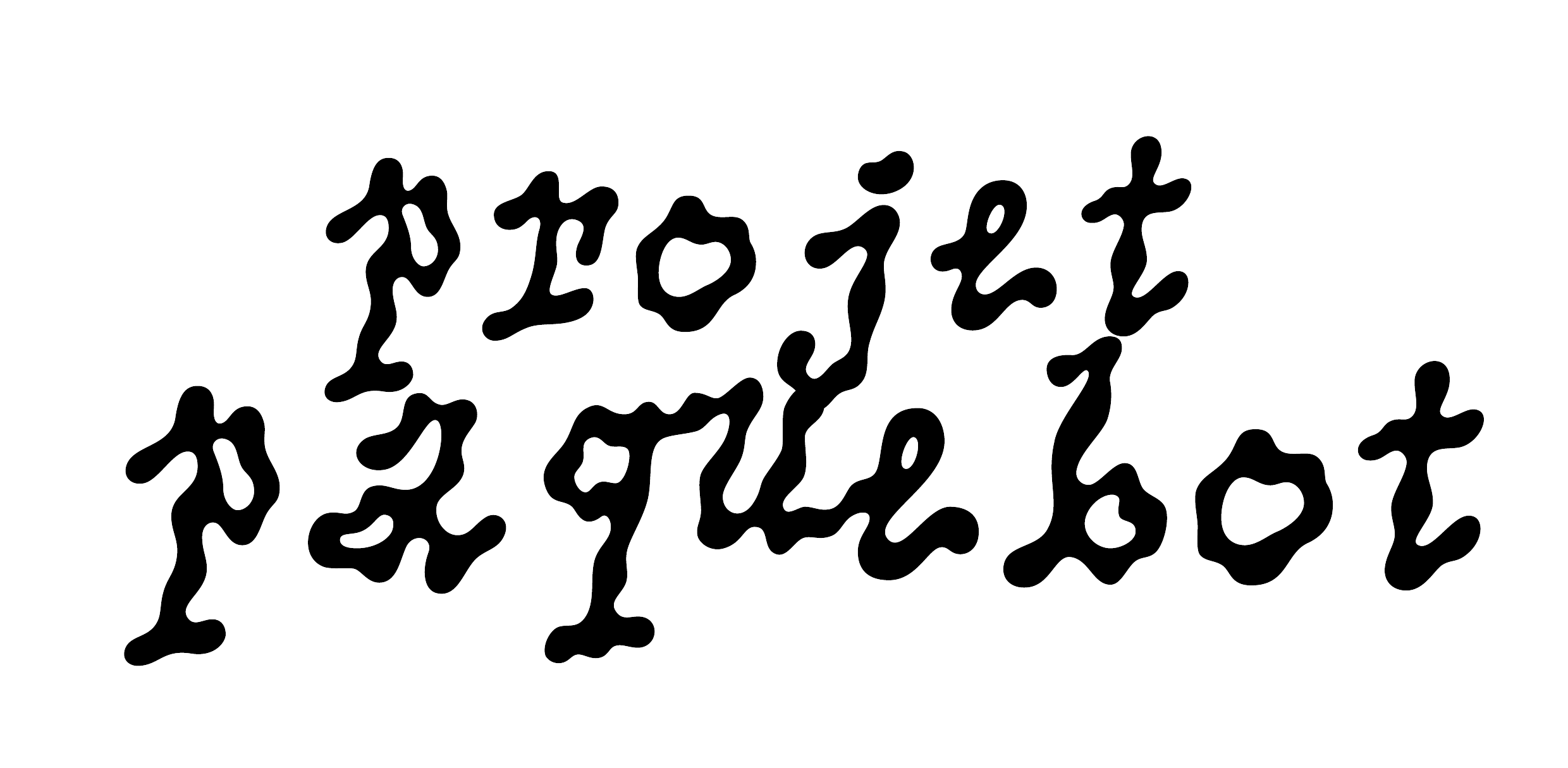T-1 : 1957-1997
En 1957, s'achevait la construction du bâtiment. Son apparence évoque celle d'un paquebot de croisière. Il s'agit en fait d'une architecture caractéristique du style éponyme, une variante du style Art Déco qui caractérise le mouvement moderne. Le bâtiment est alors pensé, lors de l'expansion du Port de pêche du Rosmeur, pour accueillir un grand restaurant vue-sur-mer. Au rez-de-chaussée, le bâtiment sert également aux fonctions administratives et de permanence de la Criée. Si le restaurant connaît un franc succès, en 1997 cependant, les normes relatives à l'amiante et le manque de rentabilité et d'entretien du bâtiment condamnent ce dernier à la vacance. En 1999, les archives sont brûlées lors d'un incendie. Si bien que ne restent que les quelques photos suivantes. Les dessins sont la résultante d'un travail de recherche et de relevé réalisé pour que la mémoire du Paquebot demeure si ce dernier en vient à être démoli.



T0 : 2025
Aujourd'hui, le bâtiment ne peut être exploré qu’au cours de visites justifiées par des motifs précis et accompagnées du responsable de la Criée ; seuls les pigeons et les goélands sont libres d'occuper les lieux comme ils le souhaitent. Les uns nichent à l'intérieur, tandis que les seconds pondent et couvent sur les terrasses extérieures qui évoquent le pont supérieur et inférieur d'un paquebot. La mairie et la Chambre d'Industrie et de Commerce Bretagne-Ouest (CCIMBO) ont déployé des moyens pour sécuriser et empêcher l'accès au bâtiment, pour lutter contre les tentatives de squat, sans envisager de le restaurer, arguant de son piètre état que cela serait trop coûteux à réhabiliter. Trois options s’offrent alors à eux : attendre, patiemment, qu'un investisseur privé décide de s'emparer des lieux sans prendre en considération que le bâtiment sera submergé dans moins de cent ans ; démolir le Paquebot, comme c'est le cas d'autres friches sur le port du Rosmeur ; ou de conserver le bâtiment sous cloche, fermé en l'état. La mairie a déclaré qu'elle était prête à investir entre 50 000 et 80 000 euros pour la démolition de chaque bâtiment pour pallier le manque d'argent de la Chambre. Le Fonds Vert, alloué par l'Etat, pourrait aussi être demandé et facilement obtenu par la mairie pour reconvertir le bâtiment. De nombreuses communes en ont déjà bénéficié depuis sa mise en place en 2021. L'argent est donc là et le pari est simple : je tiens à prouver que, même en dépit du Fonds Vert, il est possible de le rendre aux habitants pour 50 000 euros.

T+1 : 2026, pourquoi pas ?
Demain, voilà ce qu'il serait possible de faire pour moins de 50 000 euros : ouvrir ce bâtiment paralysé pour reconnecter la terre à la mer, rendre leurs terres et leur littoral aux douarnenistes et ainsi penser une architecture plus démocratique. En effet, l’architecture doit, d'un point de vue théorique, être remise au coeur du débat public et plus seulement destinée à une élite, tandis que d'un point de vue pratique, elle doit être inclusive et les habitants doivent pouvoir se l'approprier. Autrement dit, il s'agit de concevoir le projet architectural comme une mise à disposition d'outils spécifiques pour que chacun puisse habiter comme il le souhaite en fonction de ses besoins. Ce projet tend alors à répondre à un certains nombres de besoins identifiés, destinés aux usages locaux, plutôt qu'à s'incrire dans une logique programmative plus classique. Le dessin et les transformations de l'existant découlent donc de la conjonction de besoins matériels et techniques, de besoins humains primaires et de besoins inhérents, tout en les insérant au plus près de la géographie de Douarnenez. Parler de géographie c'est ici prendre en compte à la fois les dynamiques et les flux humains et non-humains, les paysages et les relations, les us et les coutumes ; lorsque parler de contexte seul serait réducteur. Selon la philosophe Joëlle Zask :
«Un contexte est un milieu dans lequel prend place telle ou telle conduite : un discours, une action, une croyance, etc. S’il détermine les significations et les traits de cette conduite, il n’est pas en retour affecté par elle. Les caractéristiques d’un contexte sont pensées comme indépendantes des conduites que l’on y réfère. Elles sont antérieures et peuvent être connues par elles-mêmes, indépendamment des conduites particulières qui en semblent alors des variations accidentelles. Au contraire, toute situation implique une action mutuelle, une interaction. Alors qu’une situation est définie par le fait que certains aspects du milieu se prêtent à l’action, pouvant être utilisés comme des outils de persévérance dans la vie, un contexte exprime plutôt l’ensemble des conditions qui limitent l’action. La première augmente les possibles, le second en restreint le nombre. Alors qu’un contexte est un préalable, une condition antécédente, une situation est un résultat. Le premier est immuable, la seconde change. »
J. Zask, «Situation ou contexte ? Une lecture de Dewey.», Revue internationale de philosophie, 2008, 245(3), 313-328.